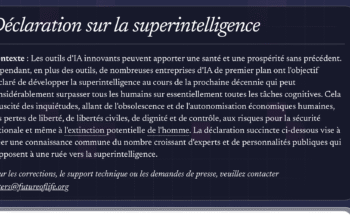Le philosophe Miguel de Unamuno n’a pas prévu de parler. Il n’a donc pas écrit de discours de clôture pour cette «Journée de la race espagnole» – l’anniversaire de la découverte de l’Amérique – que le camp nationaliste célèbre en ce 12 octobre 1936 à l’université de Salamanque. L’Espagne est alors saisie par la guerre civile, déchirée en deux, et c’est dans le palais épiscopal de cette vieille cité que le général Franco a établi ses quartiers, à deux cents mètres de là.
En sa qualité de recteur perpétuel, l’écrivain est assis à son fauteuil dans la tribune du grand amphithéâtre, écoutant les autres recteurs qui célèbrent les valeurs de l’ordre nouveau. A ses côtés, sous une photo sépia du Caudillo, il y a précisément l’épouse de celui-ci, Carmen Polo. Le goupillon est représenté par l’archevêque. Le glaive est tenu par un revenant des ténèbres : le général José Millán-Astray, fondateur de la Légion espagnole et officier le plus décoré d’Espagne.
«Cri mortifère»
C’est plus un épouvantail qu’un homme, le spectre même de la guerre : une balle lui a traversé la tête, fracassant sa mâchoire et lui arrachant l’œil droit, dont la cavité est dissimulée sous un bandeau noir. Il a aussi perdu le bras gauche et plusieurs doigts à l’autre main. Mais ses blessures et faits d’armes coloniaux font qu’il est la coqueluche des jeunes officiers nationalistes. De temps en temps, il ponctue les allocutions de son cri de guerre : «Espagne.» L’assemblée, des responsables franquistes et des phalangistes en chemises bleues, lui répond avec le salut fasciste et les trois formules rituelles : «Une», «grande», «libre».
Le professeur Francisco Maldonado vient de s’exprimer, désignant les nationalistes basques et catalans comme «le cancer de la nation». Un autre cri de guerre retentit, celui de la Légion : «Viva la muerte !», que reprend Millán-Astray. Puis, toute l’assemblée se braque sur Unamuno. On sait qu’il méprise l’officier. Et qu’il est incapable de se taire. En 1917, lors d’une autre crise, il avait lancé : «Fondamentalement, je ne suis rien de plus qu’une parole, et comme ne pas parler c’est mourir, franchement, je ne suis pas disposé à mourir.»
Le vieux philosophe se lève, pose sa voix et engage le duel : «A l’instant, je viens d’entendre un cri mortifère et insensé : "Vive la mort !" Et, moi qui ai passé ma vie à forger des paradoxes, je peux vous dire avec l’autorité d’un expert que ce paradoxe incongru me répugne.» Là, le verbe de Unamuno se fait lame, pour percer jusqu’à l’âme le légionnaire : «Le général Millán-Astray est un infirme […]. Tout comme l’était Cervantès [blessé, à la bataille de Lépante contre les Turcs, il avait perdu l’usage d’un bras, ndlr]. Un infirme, qui n’a pas la grandeur spirituelle de Cervantès, est porté à rechercher un terrible soulagement en multipliant les mutilés autour de lui. Le général Millán-Astray aimerait recréer l’Espagne de toutes pièces, une création à son image et à sa ressemblance ; c’est pour cette raison qu’il souhaite voir une Espagne mutilée […].»
Est-ce le cœur qui a fait s’emballer la raison du philosophe ? Ou est-ce la raison qui a fait jaillir le cœur ? Millán-Astray, lui, explose de rage. D’autant plus que Unamuno n’est pas considéré comme un «rouge». Sinon, il aurait été destitué, embastillé, voire tué. Certes, il a été le grand intellectuel de la République, mais celle-ci lui a retiré depuis ses honneurs. L’homme, qui a passé trente-six ans dans le siècle précédent et autant dans celui-ci, est un conservateur, profondément catholique, professant un existentialisme chrétien proche de Kierkegaard – pour lire le philosophe protestant, il a même appris le danois. A l’université de Salamanque, qui fut l’une des quatre premières universités avec la Sorbonne, Oxford et Bologne, il est à cent coudées au-dessus des autres professeurs.
C’est un homme engagé dan
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien