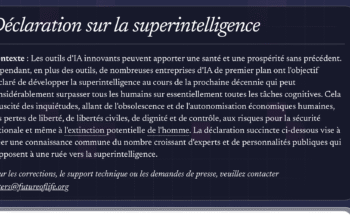Dans sa grande majorité, le public est masculin, blanc, populaire, la cinquantaine bedonnante. C’est une foule d’ex-adolescents des années 70 qui ont grandi la tête dans les nappes sonores du rock progressif – feulement de la guitare, harmonie tubulaire du synthétiseur, batterie enchaînant les «breaks» -, mais les pieds lourdement lestés au sol par la crise économique qui commençait. «J’ai vu Pink Floyd ici en 1977. C’était mon premier concert», raconte un Néerlandais venu en voisin, look de camionneur baba, collectionneur exalté de vinyles rares et de dédicaces. On est à Anvers, au point d’intersection de l’appauvrissement local et de la prospérité globale. Dans la salle, on peut sentir le désir de fidélité à la vieille utopie qui émanait des meilleurs morceaux de Pink Floyd : une musique mettant l’infini à portée de chacun.
Entamée l’année dernière, la tournée mondiale de The Wall par Roger Waters fait, ici comme ailleurs, stade comble. Les moyens déployés sont considérables : 85 millions de dollars, selon le Financial Times. Certes, l’homme, endurant mais arrogant, n’est pas le visage le plus riant de Pink Floyd. L’album-concept dont est tiré le spectacle n’en constitue pas non plus l’œuvre la plus marquante. Les puristes préfèrent les premiers albums, d’autres voient dans le classique Wish You Were Here l’aboutissement de la musique avec synthétiseur, Meddle a son club de fans, et l’on ne saurait trop recommander Ummagumma, oublié à tort. Moins inventif, The Wall (1979) fut pourtant un moment de vérité pour le groupe, marquant tout à la fois la prise de pouvoir de Roger Waters, le renoncement à l’esthétique cosmique et le retour en force des fantômes de la Seconde Guerre mondiale, véritable refoulé de cette génération.
Traumatisme. Roger Waters, 68 ans, entre en scène : T-shirt et jean noir, baskets blanches, ventre plat, légèrement voûté – mais il l’était déjà dans Pink Floyd à Pompéi. Il ressemble à Clint Eastwood, n’est pas une bête de scène, mais la scénographie est entièrement conçue autour de lui, de sa musique, de sa personne et du traumatisme qui a dominé sa vie. Sifflements, explosions, pétarade des feux d’artifice, bombardiers en ombre chinoise, projecteur d’hélicoptère braqué sur la foule, tout participe à l’évocation compulsive de son père, Eric Waters, soldat de sa Majesté mort en 1944 à Anzio, en Italie, dont la fiche signalétique est brusquement projetée en fond de décor. «Dead, you hear the falling bombs ?» chante Waters dans la superbe Goodbye Blue Sky.
The Wall raconte l’histoire de Pink. Son père est mort à la guerre, sa mère le surprotège, ses professeurs le tyrannisent, sa femme le déçoit et le trompe. Devenu rock star, il bâtit un mur autour de lui et se transforme en dictateur. Un récit grandiloquent, porte ouverte à tous les dérapages musicaux : chœurs d’enfants, orchestre symphonique, basse disco. Etrangement, en live, les traces de mauvais goût gênent moins. On prend à la rigolade les poupées géantes représentant le professeur, la mère et la femme, qui s’agitent dans les airs comme pour un défilé de corso fleuri. Et quand une cohorte d’enfants (à Paris, ils viendront d’Aulnay-sous-Bois) se déhanche sur «Hey, teachers, leave the kids alone», pas toujours en rythme mais avec une présence incroyable, on est bouleversé.
Les photos de victimes de la folie humaine se succèdent en fond de décor : un enfant irakien, une victime du 11 Septembre, un soldat de la Wehrmacht, une Iranienne. Des mains invisibles empilent les briques géantes. Le mur monte, devient un gigantesque écran où les images déferlent. Au début de la reprise de Another Brick in the Wall, les coups portés par le tandem basse-batterie se confondent avec le bruit sourd d’une masse qui frappe un écran de télévision, le fragmentant en dix, puis en cent, pui
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien