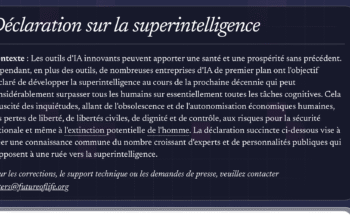Reprendre la main, c’est parvenir à imposer son langage, au lieu de subir celui de l’adversaire. Car c’est bien la difficulté aujourd’hui : comment parvenir à faire entendre un discours de gauche, quand on parle avec les mots de la droite ? Comment emporter les batailles, si on ne les livre jamais sur son propre terrain ? Il en va donc, au premier chef, du contrôle du vocabulaire politique. On sait par exemple que tant qu’on continuera de parler, au lieu de « cotisations », de « charges », celles-ci vont immanquablement « peser » ; elles paraîtront forcément « trop lourdes », et la seule politique raisonnable sera, inévitablement, leur « allégement ». C’est que le langage nous parle autant que nous le parlons.
Se laisser imposer les termes du débat, c’est presque avoir perdu la partie d’avance, car c’est parler la langue de l’adversaire. Il en va de même du « problème de l’immigration ». Depuis les années 1980, sous couvert de lutte contre le Front national, les majorités républicaines des deux bords prétendent s’attaquer, non à l’immigration elle-même, certes (à les en croire, c’est toute la différence avec l’extrême droite), mais au problème qu’elle représenterait. On affirme ainsi éviter la xénophobie, voire lui répondre. En réalité, c’est reprendre à son compte, avec ce vocable, une problématisation, soit une construction qui constitue l’immigration en problème, et ainsi pose les conditions de la xénophobie politique au motif de la combattre.
Il ne faut donc pas s’étonner si la politique menée sous François Hollande s’inscrit dans la continuité de celle de Nicolas Sarkozy. On n’a pas changé de problématique. Ainsi, lorsque Le Figaro lance le 8 octobre 2013 une controverse sur les chiffres des reconduites à la frontière de sans-papiers (« Les expulsions de clandestins en chute libre »), le ministère de l’Intérieur riposte en se vantant de faire mieux, c’est-à-dire plus que son prédécesseur de droite. Juste avant les élections municipales, le 11 mars 2014, Manuel Valls promulguera d’ailleurs une circulaire confirmant qu’il n’a nullement rompu avec la politique du chiffre revendiquée par Nicolas Sarkozy. Il s’agit bien, une fois encore, d’une bataille sur les mots.
Prenons le mot « intégration ». On a pu voir combien le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait reculé sur ce front dès les premières attaques lancées par Le Figaro le 12 décembre 2013 contre des rapports qui contestaient ce lexique – à tel point qu’on a pu se demander si la politique d’intégration n’était pas définie par les éditoriaux du quotidien de la droite. En réalité, un déplacement s’est opéré à partir des années 1980. Sans doute le mot « intégration » apparaît-il moins contraignant que « l’assimilation ». Toutefois, derrière le substantif, le verbe a changé sans qu’on en prenne vraiment conscience : « intégrer » a cédé la place à « s’intégrer ». Le glissement, du verbe transitif à la forme pronominale, est d’importance : il fait basculer la responsabilité de l’intégration de la société à l’immigré. En conséquence, celui-ci est soumis à une question indéfiniment renouvelée, sans qu’aucune réponse puisse jamais répondre à cette injonction sans fin. Ainsi, l’intégration aussi devient un problème insoluble.
Reprendre la main, ce serait donc changer de verbe. Il en va de même pour le « problème » de l’immigration. Il suffirait de distinguer « être » et « avoir » pour restaurer la différence entre droite et gauche. Pour la droite, l’immigration est un problème, par définition ; en revanche, pour la gauche, on dira qu’il y a des problèmes en matière d’immigration. Pour bien mesurer l’enjeu de la distinction, il suffit de prendre quelques comparaisons. Chacun s’accorde à reconnaître que le chômage est un problème ; mais une polit
via www.mediapart.fr