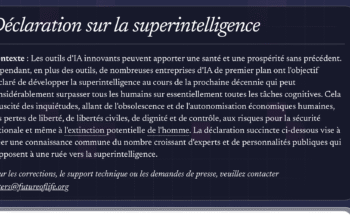Ci-dessous, vous trouvez un extrait d’une série d’articles publiés par Médiapart, et dont les auteurs sont Romaric Godin et Ellen Salvi. Il s’agit d’extraits, puisque les articles complets sont accessibles ici, par abonnement.
La présentation de cette série est ainsi effectuée : « Une nouvelle génération d’écrivains réactionnaires a émergé dans les années 1990 au moment de l’avènement de l’autofiction. Ils étaient alors considérés comme des auteurs impertinents, parfois même classés à gauche. Mais avec le temps, ils ont fini par épouser les paniques morales de notre époque. Histoire d’une dérive littéraire. » La série paraît inspirée par l’ouvrage de François Krug, « Réactions françaises« . Et pour mesurer l’ampleur de ces « réactions », il faut lire le texte précieux et très informé de Jean-Yves Mollier, « L’édition française dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale« , publié par la revue « Vingtième Siècle, revue d’Histoire », fin 2011, dont une partie de la présentation est parfaitement claire : « Archives inédites à l’appui, Jean-Yves Mollier démontre ici au contraire que, s’il y eut quelques éditeurs résistants, l’essentiel de la profession mit bien en œuvre une réelle « collaboration intellectuelle », prolongeant de cette manière un « habitus de soumission » vieux de plus d’un siècle.« . 1940-1945, et aujourd’hui : une continuité, et non une discontinuité, ou même une négation.
Le premier article a été co-écrit par les deux auteurs mentionnés :
« L’un s’est dit « incapable d’aimer une femme de 50 ans ». L’autre préférerait que l’on parlede « jeunes chattes humides » plutôt que de « jeunes filles en fleurs ». Le troisième estime que seule « la peur de la prison ferme retient les hommes d’agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent ». Quant au dernier, il a plusieurs fois porté, au fil de ses récits de voyage, un regard misogyne sur ces « vieilles filles » qui « atteignent l’âge de non-retour ». À eux quatre, ils ont vendu des millions de livres. Ils s’appellent Yann Moix, Michel Houellebecq, Frédéric Beigbeder et Sylvain Tesson. Avec d’autres, ils ont répandu depuis les années 1990 leurs ego littéraires partout, de traductions en adaptations cinématographiques, de plateaux de télévision en colonnes de journaux. Chroniqueurs sur Europe 1 ou au Figaro Magazine, on les croise aussi dans les colonnes de Valeurs actuelles ou sur les plateaux de Cyril Hanouna, de Pascal Praud ou de Mathieu Bock-Côté, qui en ont fait leurs nouvelles coqueluches.Longtemps considérés comme des auteurs impertinents, parfois même classés à gauche, ils sont devenus les béquilles plus ou moins solides du grand mouvement de droitisation de la société française. Avec le temps, ils ont fini par épouser les paniques morales de notre époque : certains sont obsédés par l’islam, d’autres fustigent le « wokisme », tous redoutent les féministes. Chacun à leur façon, ils représentent aujourd’hui les fers de lance de « la lutte contre le politiquement correct ». » A EUX QUATRE, ILS ONT VENDU DES MILLIONS DE LIVRES. Autrement dit : comme la corruption politique, ils n’auraient rien été, sans la corruption civique. « Depuis quelques années, ces auteurs se sont trouvé un nouveau point commun : le rejet du féminisme contemporain et du mouvement #MeToo, qui a provoqué chez eux une panique générale. » (…) « Un texte les rassemble tous, par son inventivité stylistique et son rejet violent de la modernité : Voyage au bout de la nuit (Denoël et Steele, 1932) de Louis-Ferdinand Céline. Le « livre qui a changé [la] vie » de Yann Moix. Celui dont Sylvain Tesson fredonnait l’exergue lors de son « épopée » en side-carentre Moscou et Paris, racontée dans Berezina (Guérin, 2015). Celui qui fit office de « dépucelage mental » pour Frédéric Beigbeder. Et que même Michel Houellebecq « aime bien », lui qui n’apprécie guère Céline en dehors de ses pamphlets antisémites qu’il trouve « pas mal ». » Le Celine Way of Life est une garantie de fange. « Pour imposer leur vérité au-delà des pages de leurs livres, ces auteurs réactionnaires renouent avec une forme de mercenariat. Yann Moix le revendiquait récemment dans L’Express : « Je n’ai pas honte de dire que je dois sponsoriser mon écriture, je suis mon propre mécène. » Mais pour être un bon sponsor de soi-même, il faut caresser l’air du temps, fût-il rance. Faire polémique. Et s’attaquer à tous les « -isme » qui nous tombent sous la main : « wokisme », « néoféminisme », « islamisme », « écologisme »… Bref, suivre la même stratégie que les égaré·es de la politique. »
Le second texte a pour auteur Romaric Godin, et concerne Philippe Sollers, sous le titre « Sollers 1983 : la contre-révolution littéraire« .
« Le 5 mai 2023, la mort de Philippe Sollers aurait pu être un événement. L’écrivain de 86 ans n’avait pas seulement été un des papes de la littérature française depuis quatre décennies, il avait aussi été un des auteurs les plus médiatiques et donc des plus influents des années 1980 et 1990. Pendant trois décennies, il a inondé la presse de ses articles et chroniques et la télévision de sa présence, et pas seulement dans les émissions littéraires. Pourtant, en ce mois de mai 2023, ce décès n’a pas été un événement majeur, pas même dans le milieu littéraire. La presse nationale a publié des nécrologies convenues, ou complaisantes parce que écrite par des proches (comme celle de Philippe Forest dans Le Monde), ou largement descriptives. Le texte d’hommage de l’Élysée, assommante notice de manuel d’histoire littéraire, par ailleurs parsemée d’erreurs factuelles, n’a guère remonté le niveau. En une journée, l’affaire était réglée. On pouvait passer à autre chose. La comparaison avec d’autres auteurs est cruelle pour celui qui a placé au centre de son œuvre le culte du « grand écrivain ». Ici, nulle réflexion sur la postérité de son œuvre, aucune analyse au long cours de son influence ou de son style. Pas de branle-bas de combat dans les librairies pour profiter de l’aubaine. Ces hommages ressemblaient plus à de simples et obligés constats de décès. » Dans les années 70, Philippe Sollers aura été un Autre : il a été pris pour quelqu’un d’autre, il s’est fait prendre pour quelqu’un d’autre. Baigné d’une culture « catholique », l’intelligentsia parisienne rêve d’un super-structuralisme, via la « Linguistique », et pendant un temps, Sollers fait partie d’un groupe qui rêve de relier les langues européennes à, notamment, la langue chinoise, en créant ainsi un internationalisme indispensable, dans la compréhension des uns par les autres. Le projet est titanesque, et requiert des travailleurs obscurs. Or Sollers veut de la « lumière » : écrivain, il sait qu’il n’est rien, comparé aux rock-stars, même aux plus nuls des chanteurs de la chanson française, et, typiquement auteur, donc avec une haute opinion de lui-même, il est scandalisé de ne pas faire scandale par une telle démarche, pourtant sulfureuse en pays capitaliste. Alors, il va aller à la facilité. « Oenologue », si la culture vivante est un vin dans laquelle notre sang infuse, il flaire un processus culturel, politique, majeur, avec la montée en puissance des Femmes. Et c’est ainsi qu’il titre son ouvrage du début des années 80, qui lui assure renommée et revenus complémentaires : « Femmes est donc un événement littéraire, soigneusement préparé par Gallimard pendant des mois. Le livre sera non seulement lisible et accessible, mais ce sera surtout un règlement de comptes avec le passé. Un roman à clés où toute l’intelligentsia parisienne des années 1970 défilera et en prendra pour son grade. Et pour solde de tout compte, il s’agira aussi d’une attaque frontale contre la modernité, autrement dit contre ce que le groupe Tel Quel avait, sur le plan littéraire, cherché à construire. Ce roman est donc bien le « tournant de la rigueur » de la littérature française, celui par lequel l’ancien défenseur de l’avant-garde et de la dissolution du sujet littéraire devient auteur d’une autofiction désabusée et conservatrice. On n’est ici pas si loin de ces ministres socialistes qui avaient, pendant dix ans, défendu l’autogestion et le dépassement du capitalisme, et qui, en ce même printemps 1983, donnent désormais au public des cours de monétarisme et d’orthodoxie financière dans le but de soutenir les profits. » « Rappelons rapidement l’argument principal de ce long roman. Un journaliste états-unien écrit avec un écrivain maudit français, baptisé subtilement « S », un roman titré Femmes sur sa résistance à la domination de la société par les femmes et leurs alliés homosexuels. Cette domination est ainsi résumée : « Les mères, les homos, malgré leur rivalité apparente, ce sont comme qui dirait les kapos du camp invisible » (page 43). » Cette dernière phrase est emblématique de ce que Sollers va mettre en oeuvre, de cette époque jusqu’à la fin : la démagogie la plus grossière, par la grossièreté, l’excès, afin de se garantir une publicité. Or l’époque est celle de la montée en puissance de cette industrie sophistique, couronnée par le prétendu succès de la campagne du pubard, Jacques Séguéla, celle de François Mitterrand en 1981. Pour exister, il faut parler de plus en plus fort, et les actuels « bruits et fureurs » de quelques chaînes et émissions, radiophoniques et télévisuelles, en sont les prolongements. Les caricaturistes et menteurs n’ont jamais eu cure de dire vrai, mais seulement d’être performants. Là où Sollers est un obsédé sexuel/textuel comme les autres, le personnage, mâle, central, de « Femmes » est plutôt un Don Juan, un double rêvé de Sollers qui n’avait pas le physique pour. Mais la classe politique française démontre que, pour les hommes de pouvoir, laids, le dit pouvoir politique garantit d’être écouté par des femmes, et, pour certaines, d’obtenir des faveurs, ce que, sans ce pouvoir, ils ne pourraient jamais envisager. Sur des malentendus, Sollers a donc dû prospérer, et se confondre avec certains de ces personnages. L’auteur se prend pour un héros, qui mènerait un combat titanesque : « Le FAM, le WOMANN et le SGIC sont, dans Femmes, des sociétés plus ou moins secrètes féministes et homosexuelles (SGIC veut dire Sodome et Gomorrhe International Council) qui cherchent à imposer la domination ouverte de la femme sur la société pour en éliminer les signes de liberté incarnés par l’écrivain. D’ailleurs, le WOMANN voudrait explicitement « éliminer de l’enseignement, de la littérature et de l’art tous les éléments pouvant être considérés comme sexistes ou machistes » (page 53). Et l’action serait centrée sur les « génies » qui « devront être soit sérieusement expurgés ou du moins relativisés, soit purement et simplement interdits ». Logiquement, ils essaieront dans le roman de tuer le narrateur… Eh oui, Femmes est aussi le roman de la première panique morale face à ce que l’extrême droite appellera la « cancel culture ». » Or, donner ainsi à des hommes très ordinaires le sentiment d’être le sujet, la victime, d’une révolution en marche, autrement dit à des milliers d’hommes, bourgeois, tristes, fades, ennuyeux comme la mort, méprisés par leurs épouses et leurs filles, constituait une revanche, alors qu’ils avaient la volonté de hurler contre ces femmes, voire même de les tuer. « Avec une telle critique, l’affaire était entendue. Femmes devient le roman de l’année 1983. Il est parfaitement en phase avec son temps, lui qui pourtant prétend s’extraire de la bouillie du temps. À la surprise de beaucoup, l’écrivain jadis illisible réalise là un vrai succès de librairie. Pendant plusieurs semaines, il joue les premiers rôles dans la liste des ventes de livres de L’Express« . En quelques années, le catholique (et franc-maçon ?) auto-proclamé tombe la tenue de l’auteur germano-pratin, pour celle du « Prophète » qui aligne les citations, arguments autoritaires d’autorité, offertes à l’interprétation du lecteur. Gestionnaire de rentes littéraires, il répète que « tout a été dit », refuge « éternel » des stériles qui préfèrent ignorer l’Histoire et ses mutations. Et alors que l’Histoire en marche devient la publicité de « moi-je » libertariens/libéraux, Sollers préfère se faire écho de ces Egos, ce que Romaric Godin conclut également avec sévérité.
Le troisième texte de cette série concerne Frédéric Beigbeder. Fils de, frère de, petit-fils de, il a fait partie de la jeunesse dorée parisienne. Temps libre subventionné par les fortunes familiales, la grande question lorsque ces adolescents boutonneux deviennent des « adultes » est : que devenir, quelle voie choisir ? Un auteur, connu, reconnu, qui, sur des malentendus, vend des livres, permet de maximiser le temps à ne rien faire, tout en maintenant un mécénat public, par des inconnus qui ne savent pas ce qu’ils font, donnent. En outre, pour des narcissiques XXL, les livres publiés sont toujours associés à leur « Je », éventuellement géniaux, mais toujours proclamés tels par la publicité. Et Beigbeder est son propre produit, lui qui a été un pubard, faiseur de phrases, comme le fut en son temps un Jean Jardin. Le texte d’Ellen Salvi est constitué par des citations du sieur, et par les commentaires de ces propos. Or nombre de ces propos sont volontairement, provocateurs, grossiers, manichéens, faits pour capter l’attention des adultes, encore enfants. Pour comprendre Beigbeder, il faut prendre en compte, avant tout, les actes. ll vit dans un petit monde parisien, ploutocrate, dont il est une émanation, et il méprise celles et ceux qui n’en font pas partie. C’est un communautariste casanier, dont toute la vie se passe dans un cercle parisien, suffisant, parce que, en effet, rien ne l’oblige à vouloir s’intéresser à ce qui dépasse ce petit monde, dont, hélas, l’influence en France est énorme, et ce sans aucun rapport avec la valeur de ces « influenceurs ». Il a été un auto-satisfait dans l’ombre d’Ardisson, roi des auto-satisfaits, un auto-satisfait au Café le Flore, un auto-satisfait dans ses passages radio. Ni la mort, ni l’Histoire du monde, rien n’existe dans son monde. L’Angoisse lui est inconnue, et seuls les cumuls des plaisirs existent. Difficile de faire une oeuvre avec aussi peu. Alors, in fine, voilà que, après un passage médiatisé dans une abbaye avec quelques autres VIP de la littérature germano-pratine, il concède une peur face à l’acte terroriste. Mais qui peut croire à cette déclaration ? Quand il parle, il communique : il s’agit de faire parler de lui, et, depuis Sollers, le meilleur moyen est de s’en prendre aux femmes. Forcément, elles voient « rouge », enfin, brun. Succès garanti : et pour ses clients, les acheteurs de ses auto-satisfactions imprimées à plus de deux cent pages, des hommes et principalement des hommes d’extreme-droite, s’en prendre aux femmes est un must, qu’ils félicitent ainsi, par quelques euros donnés pour financer ses agapes. Alors, dans les actes, il a fait l’éloge de Matzneff, et dissimule son soutien en affirmant qu’il ne l’a jamais pris au sérieux. Mais pourquoi faudrait-il prendre au sérieux les affirmations de Beigbeder sur lui-même et ses amis ? Il sait que, aujourd’hui, cet éloge est risqué. Et, d’ailleurs, des femmes ont témoigné sur et contre lui. Mis en cause pour ce qu’il a lui-même fait, il répond comme si c’était son genre, masculin, qui était mis en cause, pratiquant l’amalgame du cas particulier avec le général : « La veille de son intervention, la devanture de la librairie » (Mollat à Bordeaux) « a été recouverte de collages féministes, sur lesquels on pouvait notamment lire : « Tu as un discours de violeur », « Les hommes cis bénéficient du patriarcat avant d’en être les victimes », « Personne veut te sucer Beigbeder », « 176 pages de branlette misogyne »… L’auteur est très inquiet. Sur BFMTV, il s’insurge contre ces féministes qui veulent le « censurer ». Le « Gramsci de la branchitude » s’est transformé en boomer de la bataille culturelle. » S’il n’avoue pas des agressions sexuelles, des viols, il fait savoir qu’il en a les pensées, en affirmant « « La peur de la prison ferme retient les hommes d’agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. » Puis : « Il est effrayant de se retenir toute la journée de sauter sur les femmes. » Mais aussi : « Nous devons nous masturber constamment pour ne pas basculer dans la folie criminelle. » Ou encore : « S’il n’y avait rien pour nous limiter, on se ferait sucer toute la journée par des femmes. »« . Mais quels hommes dignes de ce nom peuvent se reconnaître dans un portrait aussi caricatural, violent et criminel ? Dans la vie comme dans ses textes, l’obsession sexuelle est constante. Il faut qu’il se vante de ses conquêtes, qu’il vante le Don Juan. De Sollers jusqu’à Beigbeder, c’est le même personnage parisien qui passe son temps à se vanter de son priapisme : le queutard. En faisant référence à Sade, en faisant son éloge constant, Sollers avouait une filiation, terrible. Et depuis deux siècles, Paris aura été, est aux mains des Sadiens/sadiques. Et tous leurs vices (qu’ils assument, dont ils sont fiers) sont ceux qui font une partie de l’actualité sociale et politique de ces dernières années, des agressions sexuelles contre les femmes, de la pédocriminalité, des fêtes sexuelles, dont des fêtes BDSM extrêmes. Un talon d’Achille, susceptible de causer leur perte.