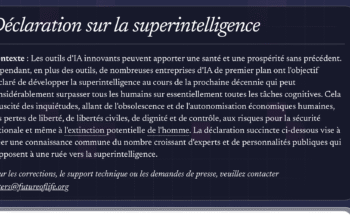Comment expliquez-vous qu’Access International Advisor ait choisi de vous recruter ?
Mon nom a joué un rôle incontestable. Pas aristocratique puisqu’il faut être catholique pour ça. Mais je suis issu d’une vieille famille de propriétaires terriens, et je suis né dans un château. Sans être fortuné, je maîtrise les codes de la haute société de la Vieille Europe. Access recherchait ce profil, le même que celui de ses investisseurs. En plus, ma mère est américaine, et j’avais la double nationalité : non seulement je maîtrisais la langue mais il n’y avait pas de problème de visa. Ils avaient besoin de quelqu’un, j’étais le type idéal.
La finance, c’était une ambition ?
Plutôt une occasion. Durant ma scolarité, j’avais multiplié les stages à l’étranger, en Russie, en Inde, au Brésil. Pendant des mois, j’ai cherché un job à l’étranger, dans l’immobilier. Mais rien. J’avais un gros emprunt sur le dos, alors la finance, a fortiori à New York, ça ne se refusait pas. Je me disais qu’avec les bonus, je pourrais tout rembourser et prendre mon indépendance. Et puis, c’était un peu suivre les traces de mon père. Après ses études à Harvard, il avait travaillé dans une banque d’affaires aux Etats-Unis, avant de tout plaquer pour aller travailler au Brésil dans le domaine agricole.
En quoi a consisté votre job au début ?
J’étais stagiaire, autrement dit corvéable à merci. Avant que je passe ma licence de broker, j’ai eu beaucoup à faire à la photocopieuse. Je gérais les agendas, l’arrivée et le séjour des clients à l’aéroport. J’avais l’impression d’être une secrétaire. On me confiait parfois des travaux d’analyse de performances de fonds ou d’indices, mais c’était loin d’être l’essentiel. En plus, mon supérieur hiérarchique faisait preuve d’une certaine malveillance.
Colocation minable, humiliations répétées, manque d’argent, intérêt de travail limité : pourquoi êtes-vous resté chez Access à New York ?
Des garçons qui avaient vécu ce que je vivais, il y en avait plein Wall Street. C’était comme une épreuve initiatique, une forme de rite de passage entre le statut de teenager et l’âge adulte. A 23 ans, ça n’a rien de naturel de se lever à l’heure le matin quoi qu’il arrive, de bosser douze heures d’affilée sans se plaindre, de gérer l’accueil de dix gros clients qui arrivent d’Europe. Ça demande de l’organisation et de la coordination. Il faut prouver qu’on a envie et qu’on n’est pas en sucre. Bosser dans la finance, ça fait fantasmer. L’argent est la compensation ultime. Mais le moteur tangible, c’est l’apprentissage de la discipline. C’est l’armée en glamour. L’armée des ambitieux.
En quoi consistait l’activité d’Access exactement ?
Access était un broker, un courtier en français, à savoir quelqu’un dont le travail est de mettre en contact un investisseur et un gérant de fonds. C’est l’intermédiaire entre un potentiel financier et un talent. La spécificité d’Access, c’est que ces clients étaient de riches et anciennes fortunes du Vieux Continent. Mon patron Thierry de la Villehuchet expliquait que le style d’argent qu’il récoltait c’était du «cold money», de l’argent stable qui appartenait à des investisseurs historiquement riches en France en Suisse ou au Royaume-Uni, et dont la préoccupation était de le rester. C’est avec cet argument qu’il a convaincu plusieurs gérants très en vue à Wall Street de travailler avec lui : c’était vrai du fonds Omega de Leon Cooperman, un des fondateurs de Goldman Sachs Asset Management, du fonds Argent de McMahan ou du fonds Madoff. Les clients d’Asset choisissaient dans quel fonds ils voulaient investir leur argent. Celui de Madoff n’était pas le plus performant mais il était régulier, déconnecté du marché. Il avait la préférence de Liliane Bettencourt.
Vous racontez que, de tous les clients d’Access, seul Patrick de Maistre, gestionnaire de fortune de
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien